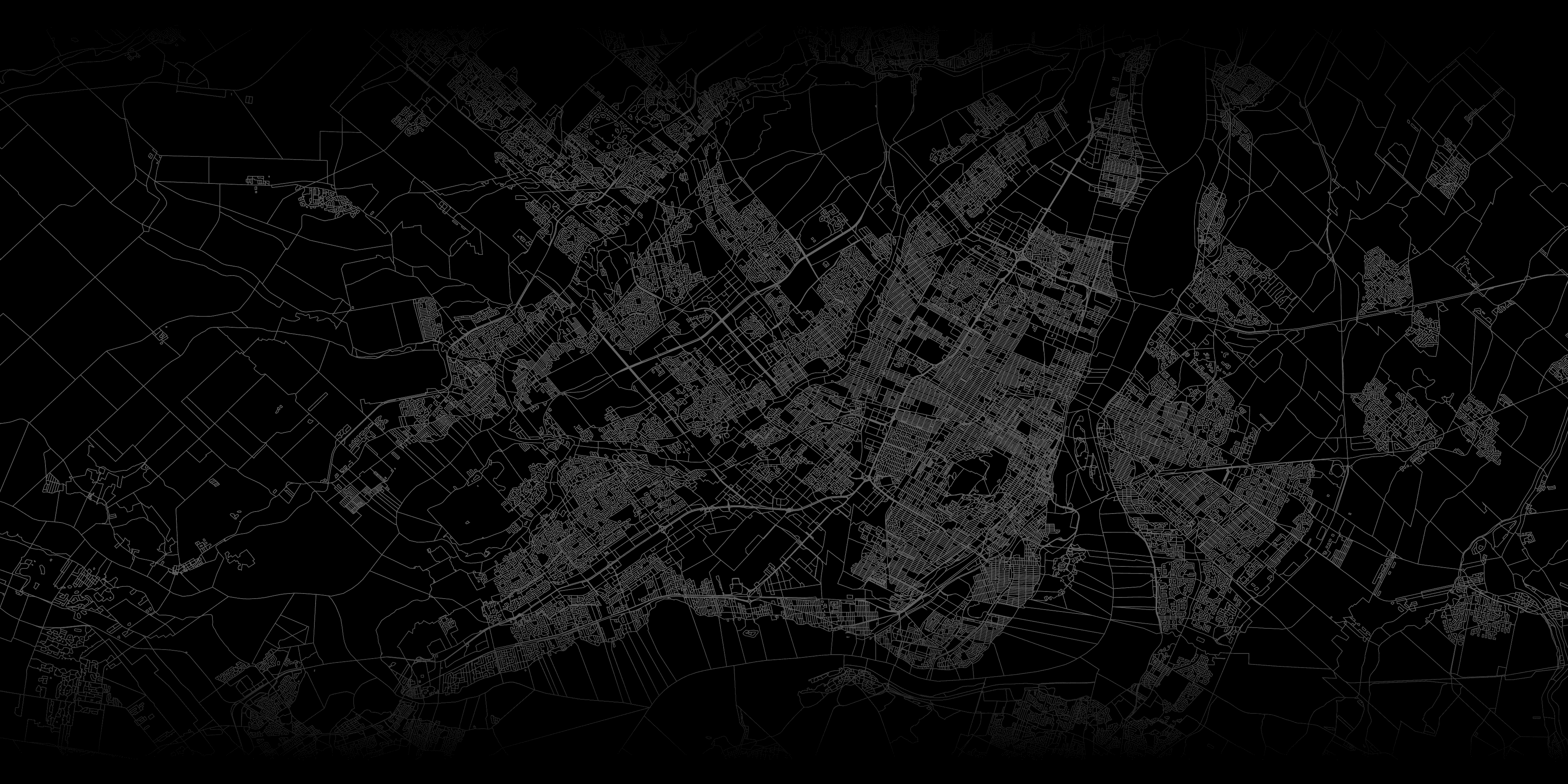Au frais sous les arbres
Pendant les chaudes journées d’été à Montréal, Jesse Hébert aime échapper à la chaleur en passant du temps dans un parc géré par des citoyens à côté de son appartement, dans le nord de la ville.
Lors d’une de ces récentes journées, alors que la température ressentie atteignait 32 °C, Jesse s’est assis à une table de pique-nique dans l’espace vert, profitant d’une fraîche brise.
Tout en admirant les pommiers et les poiriers de la cour gazonnée, il écoutait le chant des oiseaux.
« Tu te sens dans un coin à la campagne », dit-il.
Le résident, qui vit dans un logement communautaire à proximité, indique que même lorsque le thermomètre
dépasse 30 °C, la température reste agréable dans ce parc.

Surnommée La voisinerie, cette oasis urbaine est l’oeuvre de groupes communautaires locaux.
Pour Jesse Hébert, cet espace n’a plus rien à voir avec ce qu’il était il y a quelques années : un stationnement qui irradiait de la chaleur dans les environs pendant les journées d’été.
« C’était débile, témoigne-t-il. C’était vraiment chaud. »
Le nouveau parc est situé au milieu d’un bloc d’habitations sur la rue Pelletier, à Montréal-Nord, où vivent de nombreuses familles à faible revenu.
Avant d’être un espace vert, le stationnement était autrefois un lieu de rencontre notoire pour les gangs de rue. Non seulement la zone asphaltée exacerbait la chaleur ressentie par les résidents, mais c’était aussi le théâtre d’activités criminelles, dont le trafic de stupéfiants.
« Tout le monde restait chez eux parce que les gangs de rue prenaient possession du stationnement », se
remémore Jesse Hébert.

Désormais, le citoyen profite du lieu avec sa compagne et son fils de quatre ans, Brandon, en faisant pousser des légumes dans le potager.
L’asphalte a été retiré et remplacé par des framboisiers, un jardin communautaire, du gazon et des arbres. Ce n’est pas parfait – il y a encore du vandalisme et des jeunes qui causent parfois des problèmes – mais c’est beaucoup mieux.
« Le changement climatique, c’est de pire en pire, souligne-t-il. On a une place qui est agréable, où l’air
est bon, où les oiseaux chantent. [...] C’est super. Il devrait y en avoir plus, beaucoup plus. »

Pour Paul Lévesque, qui a été invité à jardiner par un ami, participer à ce projet local est un plaisir.
Il habite dans le quartier et prend l’autobus presque tous les jours pour faire du bénévolat pour La voisinerie.
« C’est bon pour l’environnement », dit-il.
Il montre les vignes qu’il cultive pour créer davantage de zones ombragées.
Le projet de l’Îlot Pelletier, achevé en 2018, s’inscrit dans une démarche du Québec pour réduire les îlots de chaleur urbains dans les quartiers défavorisés.
La Ville de Montréal a un plan d’intervention en cas de vague de chaleur qui comprend une foule de mesures, dont des heures prolongées pour les piscines publiques, des abris de refroidissement d’urgence et du porte-à-porte dans les quartiers vulnérables.
Mais les projets comme ce parc de Montréal-Nord priorisent la prévention plutôt que la réaction aux crises, en rendant les quartiers plus résilients à la hausse des températures.
L’initiative a été menée par l’organisme communautaire Parole d’excluEs, en partenariat avec le programme
d’Interventions locales en environnement et aménagement urbain (ILEAU) du Conseil régional de
l’environnement de Montréal.

« Nous avons de plus en plus de vagues de chaleur chaque été », indique Nilson Zepeda, le coordinateur d’ILEAU.
Il privilégie une approche holistique. En enlevant l’asphalte et en plantant de la végétation, l’objectif est non seulement de lutter contre la chaleur, mais aussi de créer des espaces qui améliorent la santé mentale et le bien-être général des résidents.
« Nous créons une communauté, ajoute-t-il. Cela ressemble à un cliché, mais il est très important de rassembler les gens. »
Depuis son lancement en 2015, ILEAU a reçu plus d’un million de dollars en financement de Québec. Plus de 30 000 plantes ont été mises en terre et plus de 3000 mètres carrés d’asphalte ont été retirés.
Pour l’Agence de la santé publique du Canada, le programme est un exemple. Il démontre qu’il est possible de lutter contre la chaleur accablante des villes grâce à des adaptations concrètes.
Mais si cet espace vert de Montréal-Nord est une réussite, c’est uniquement parce que le propriétaire, la
Société d’habitation populaire de l’Est de Montréal, un organisme de logement communautaire à but non
lucratif, était de la partie, souligne Nilson Zepeda.
L’un des plus grands défis de Nilson Zepeda est de convaincre les propriétaires privés que de troquer des places de stationnement pour des arbres en vaut la peine.
Trouver le lieu idéal, où les racines des arbres n’abîmeront pas une infrastructure souterraine, n’est pas facile non plus. Et il ne faut pas oublier que de creuser dans le béton et l’asphalte peut vite coûter cher, sans compter les frais d’entretien à long terme.
Toutefois, malgré les obstacles, les experts martèlent qu’il faut davantage d’initiatives comme ILEAU à
travers le pays pour protéger les personnes les plus vulnérables contre les chaleurs extrêmes.
Cette illustration se base sur les recherches et analyses réalisées par le programme HealthyDesign.City.
Du ciel, on voit clairement où se concentrent les arbres à Montréal.
La création de ces cartes a été financée par l’Agence de la santé publique du Canada. En superposant les données du recensement canadien avec d’autres sources d’informations, elles révèlent où vivent les populations les plus vulnérables.
Les points jaunes montrent où les facteurs de risque se chevauchent. Par exemple, les résidents sont plus susceptibles de souffrir de la chaleur dans les quartiers où le revenu moyen est bas et où l’on retrouve peu d’arbres.
Rendez-vous sur la carte interactive de l’ensemble du pays et comparez votre quartier avec les autres.

COMMENT LES ESPACES VERTS RAFRAÎCHISSENT
Que les Canadiens soient prêts ou non, d’autres vagues de chaleur vont frapper le pays, indique Scott Krayenhoff, professeur adjoint en sciences de l’atmosphère à l’École des sciences de l’environnement de l’Université de Guelph en Ontario.
« Il est difficile de savoir exactement ce qui s’en vient, mais j’ai l’impression que [...] nous nous dirigeons vers des climats différents dans nos villes, des climats que nous n’avons probablement jamais connus », dit-il.
Scott Krayenhoff étudie la chaleur urbaine et utilise des modélisations informatiques montrant à quel point
la façon dont est bâtie une ville influe sur son climat.
Tout le monde sait que l’exposition au soleil réchauffe. Il suffit de marcher sur un trottoir ensoleillé avant de traverser la rue pour se retrouver à l’ombre afin de le réaliser.
Selon les analyses de Scott Krayenhoff, se tenir sous l’ombre d’un seul arbre peut diminuer la température ressentie de 10 à 15 degrés comparativement au fait de rester au soleil lors d’une chaude journée.
Mais ce qui est moins évident à réaliser, c’est à quel point les surfaces qui nous entourent nous réchauffent aussi à cause du rayonnement infrarouge.
Si vous mettiez la paume de votre main à 50 centimètres au-dessus d’un stationnement asphalté par une
journée ensoleillée de juillet, puis au-dessus d’un carré d’herbe verte, la différence de chaleur serait
frappante.
Scott Krayenhoff explique que c’est lié au rayonnement infrarouge provenant de surfaces
comme la chaussée.
« Quand elles chauffent, ces surfaces émettent un rayonnement infrarouge qui vous
atteint lorsque vous marchez dans la rue », détaille-t-il.
Les rues bordées d’arbres aident à réduire ce rayonnement, car elles protègent du soleil les bâtiments, les
routes et les trottoirs.

QUAND L’OMBRE EST RÉSERVÉE AUX RICHES
Malheureusement, les arbres sont souvent inégalement répartis dans les villes. Et pour les Canadiens à
faible revenu, c’est un facteur qui aggrave les risques pour leur santé lors des épisodes de canicule.
Une étude publiée en 2020 soulignait que les quartiers défavorisés étaient environ deux fois moins susceptibles d’être entourés d’une végétation abondante. Cette tendance était visible à Toronto, à Montréal et à Vancouver.
Et en 2016, une autre analyse rapportait que le nombre d’appels pour des ambulances à cause de la chaleur
était environ 15 fois plus élevé dans les quartiers de Toronto ayant un couvert forestier de moins de 5 %,
comparativement aux quartiers ayant un couvert forestier de plus de 70 %.
Le militant pour une résilience aux changements climatiques Nilson Zepeda constate un exemple flagrant d’inégalité de revenus et d’accès aux espaces verts sur l’île de Montréal.
La Ville de Mont-Royal – une municipalité aisée du centre de Montréal – est connue pour ses rues bordées d’arbres et se décrit elle-même comme « une cité-jardin ». Les points verts montrent son couvert forestier.
À côté se trouve Parc-Extension, l’un des quartiers les plus pauvres au pays, selon une analyse de Centraide Montréal, qui est beaucoup moins vert. Les points jaunes montrent où le faible revenu des ménages et le manque de couverts forestier rendent les résidents vulnérables aux vagues de chaleur.
« C’est le jour et la nuit. C’est fou », indique Nilson Zepeda.
Le boulevard de l’Acadie, qui délimite les deux quartiers, accentue le contraste saisissant entre la
présence d’arbres dans les deux quartiers.

C’est pourquoi les organismes communautaires disent que la lutte contre les îlots de chaleur doit passer
par un accès plus équitable aux espaces verts.

LUTTER CONTRE LA CHALEUR INTÉRIEURE
Ce n’est pas seulement l’aménagement urbain qui devra changer si les villes veulent empêcher les décès lors des vagues de chaleur. Bon nombre de victimes succombent chez elles lors des canicules, dans des pièces et des appartements chauds et mal ventilés.
Et la climatisation seule, sans autres mesures, ne résoudra pas le problème de manière équitable.
Des simulations menées à Paris, en France, et à Houston, au Texas, ont étudié les conséquences de
l’utilisation généralisée de la climatisation dans des quartiers denses. Les résultats suggèrent qu’en
refroidissant l’intérieur de leur foyer, les résidents réchauffent l’environnement extérieur de jusqu’à 2 °C
de plus.

C’est pourquoi des experts comme Leon Wang, professeur en génie du bâtiment à l’Université Concordia, étudient d’autres façons de refroidir les bâtiments.
Selon le spécialiste, certaines bâtisses se refroidissent beaucoup plus lentement que l’air extérieur à cause de leur capacité à accumuler et à retenir la chaleur. Cela explique pourquoi les décès dus aux vagues de chaleur surviennent souvent à l’intérieur de nuit, même si les températures commencent à baisser.
Cela contribue à tuer les gens par ce qu’il décrit comme un « processus silencieux ».
« Ils se déshydratent, leur température interne grimpe à 38 °C, ils sont en danger mais ils ne le savent
pas », dit Leon Wang.
Pour refroidir les bâtiments, Leon Wang indique qu’il y a quelques caractéristiques clés à prendre en compte.
Un appartement qui a une mauvaise ventilation dans un bâtiment bien isolé sera plus susceptible de piéger la chaleur, notamment.
Des ventilateurs ou une brise passant au travers de fenêtres ouvertes sur les côtés opposés d’un logement changent tout.
Le type de fenêtre joue également un rôle.
Les grandes fenêtres non teintées laissent entrer plus de chaleur.
Les vitres teintées ou fabriquées avec des revêtements à faible émissivité réduisent la quantité de chaleur qui les traverse.
La couleur d’un bâtiment change aussi la donne.
Les bâtisses sombres, avec des briques rouges par exemple, ont tendance à absorber davantage de chaleur.
Les couleurs claires, en revanche, reflètent la chaleur.
Il en va de même pour les toits.
Remplacer les toits d’asphalte par des membranes blanches et utiliser des matériaux de couleurs froides pour les toits en pente permet de réfléchir une partie du rayonnement solaire et d’aider à garder les habitants au frais.
Leon Wang recueille en ce moment les températures à l’intérieur et à l’extérieur de plusieurs bâtiments à Montréal. Son équipe utilisera les données pour une modélisation informatique qui aidera les immeubles à travers le pays à mieux s’adapter aux variations de température.
Alors que les changements climatiques continuent d’exacerber les épisodes de chaleur extrême, les villes disposent plus que jamais d’outils pour protéger les citoyens les plus vulnérables.
Reste à savoir ce qui sera fait et dans quel laps de temps.
« Beaucoup de gens comprennent l’importance de [ce travail], mais disent que cela coûtera trop cher », souligne Nilson Zepeda.
« Mais ne rien faire sera encore plus coûteux. »